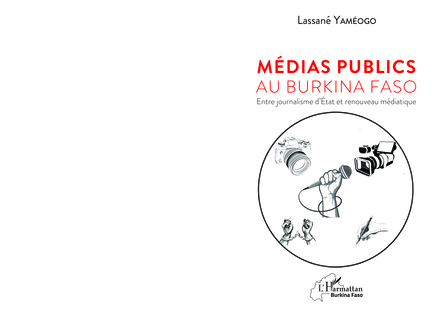Médias publics au Burkina Faso: Entre journalisme d'Etat et renouveau médiathique
Paris: L'Harmattan (2022), 444 pp.
Contains bibliogr. pp. 399-438
ISBN 978-2-14-020916-1
"La recherche révèle que dynamiques intra et interprofessionnelles et relationnelles font émerger des journalismes aux visées ambigües et contrastées. D’une part, des accommodements politiques et financiers formels et informels mêlant sanctions non dites et récompenses conduisent certains journalistes à la pratique d’un journalisme de service assimilable au journalisme d’État expérimenté dans les décennies 1960-1990. D’autre part, des formes de résistance au journalisme d’État apparaissent faisant naître par moments des velléités d’un renouveau voire d’une révolution médiatique. Ce journalisme affranchi se définit comme un journalisme d’information n’ayant pour seules références éditoriales que les règles sacro-saintes du métier et l’intérêt général. In fine, le microcosme ‘’médias publics’’ évolue dans un environnement qui le contraint à une identité éditoriale ambigüe : il n’est ni un média de service public ni un média d’État stricto sensu." (Dos de couverture)
I. CADRE THÉORIQUE, MÉTHODOLOGIQUE ET CONTEXTUEL, 25
1 Cadre théorique et méthodologique, 27
2 Notion de service public, doctrine et principes, 57
3 Contexte historico-politique d’évolution et d’exercice des médias publics, 77
II. LES INTERDÉPENDANCES DES CHAMPS JOURNALISTIQUE, POLITIQUE ET SOCIOÉCONOMIQUE, 117
1 Le sous-champ médiatique et ses dynamiques internes, 121
2 Interdépendances du champ politique et du sous-champ médiatique: journalisme d’État, censure et autocensure, 195
3 Interdépendances du champ socioéconomique et du sous-champ médiatique public: marchandisation de l’information et rapports de domination, 235
III. ANALYSE DES CONTENUS MÉDIATIQUES, 277
1 Analyse des productions médiatiques en temps ordinaire, 279
2 Analyse des productions médiatiques en temps de crise, 315
3 Crises sociopolitiques et crise du journalisme d’État: l’activisme de rue et le webactivisme comme antidotes d’un journalisme inféodé, 347
Conclusion générale, 389
1 Cadre théorique et méthodologique, 27
2 Notion de service public, doctrine et principes, 57
3 Contexte historico-politique d’évolution et d’exercice des médias publics, 77
II. LES INTERDÉPENDANCES DES CHAMPS JOURNALISTIQUE, POLITIQUE ET SOCIOÉCONOMIQUE, 117
1 Le sous-champ médiatique et ses dynamiques internes, 121
2 Interdépendances du champ politique et du sous-champ médiatique: journalisme d’État, censure et autocensure, 195
3 Interdépendances du champ socioéconomique et du sous-champ médiatique public: marchandisation de l’information et rapports de domination, 235
III. ANALYSE DES CONTENUS MÉDIATIQUES, 277
1 Analyse des productions médiatiques en temps ordinaire, 279
2 Analyse des productions médiatiques en temps de crise, 315
3 Crises sociopolitiques et crise du journalisme d’État: l’activisme de rue et le webactivisme comme antidotes d’un journalisme inféodé, 347
Conclusion générale, 389