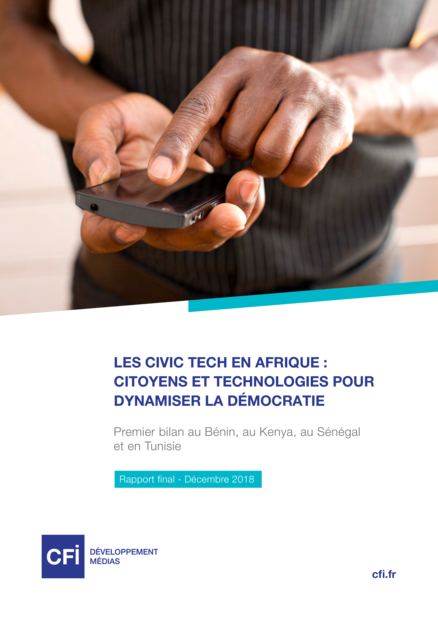Les civic tech en Afrique: Citoyens et technologies pour dynamiser la démocratie. Premier bilan au Bénin, au Kenya, au Sénégal et en Tunisie
CFI (2018), 62, 25 pp.
"Dans ces quatre pays africains (Bénin, Kenya, Sénégal, Tunisie) où l’étude a été réalisée, il apparaît qu’à l’origine des civic tech se trouvent le plus souvent des citoyens et des citoyennes engagés, désireux de traduire leur frustration, et parfois leur colère, devant le décalage observé entre l’affirmation officielle de principes démocratiques et une réalité de terrain assez éloignée des discours. Pour la grande majorité d’entre eux, les initiateurs de ces actions ont suivi des parcours universitaires exigeants et connu des expériences à l’étranger. Les hommes sont très largement majoritaires, à l’exception du Kenya où les femmes sont presque aussi nombreuses que les hommes. Elles considèrent toutefois qu’elles ne se trouvent pas sur un pied d’égalité, notamment lorsqu’il s’agit pour elles de prendre la parole publiquement ou de se lancer dans l’entrepreneuriat. Les difficultés d’une mobilisation à grande échelle Les jeunes adultes (20-25 ans) qui s’investissent dans les civic tech s’engagent généralement pour exprimer une forme d’irritation face aux dérives liées à la corruption ou au manque de prise en compte de l’avis des citoyens dans les décisions politiques. De l’avis général des « doyens » (activistes des civic tech ayant plus de 6 ou 7 ans d’expérience) que nous avons interrogés, la jeune génération est très prometteuse, car mieux formée sur les nouvelles technologies et très mobilisée sur les objectifs de bonne gouvernance et de participation citoyenne. En termes d’audience et de développement, l’étude montre que, dans les quatre pays concernés, les acteurs des civic tech rencontrent le plus souvent des difficultés à mobiliser de larges communautés de citoyens. Ils peinent à faire entendre leur message dans des pays où l’illettrisme au sens littéral et au sens numérique sont importants. Il en résulte des actions qui mobilisent essentiellement un petit nombre de citoyens, à la fois très engagés et très motivés. En général, le système d’organisation des initiatives civic tech varie selon les projets : le degré de structuration est plus ou moins formel et dépend surtout de l’ancienneté des initiatives, de l’ampleur des financements collectés et, in fine, du nombre de participants actifs impliqués à temps plein. Lorsqu’une forme de professionnalisation de l’action est évoquée, beaucoup de nos interlocuteurs mentionnent la difficulté à recruter et à fidéliser des profils combinant sensibilité aux questions de redevabilité et de transparence, savoir-faire en matière de gestion de projet, capacités technologiques et maîtrise des techniques de communication, notamment sur les réseaux sociaux." (Résumé analytique)